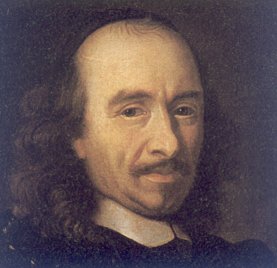 |
Pierre Corneille est né à Rouen en 1606, d'une famille de bonne bourgeoisie normande ; il est mort à paris en 1684. Il fait d'abord de brillantes études dans un collège de Jésuites, passe une licence en droit et devient avocat, comme son père, en 1624. En 1629, il confie le manuscrit d'une comédie, Mélite, à la future troupe du Marais, de passage à Rouen. À Paris, la pièce remporte un succès suffisant pour que le jeune homme décide de continuer à écrire pour le théâtre. |
| La tragi-comédie de Clitandre
(1631), des comédies, La Veuve et La Galerie du Palais
(1633), La Suivante et La Place royale (1634) plaisent elles
aussi au public parisien. Corneille reçoit une pension et Richelieu
l'engage dans le groupe des cinq auteurs chargés d'écrire
les comédies dont il invente le scénario. Une tragédie,
Médée,
est donnée au Marais en 1635, au moment où renaît le
genre. Puis Corneille revient à la comédie en 1636 avec L'Illusion
comique, où il présente une
apologie
du théâtre.
En 1637, il fait représenter le Cid ; c'est un triomphe ! Le roi confère des lettres de noblesse au père de l'auteur, et la fameuse querelle du Cid n'est que la rançon de la gloire. Déçu cependant par les Sentiments de l'Académie sur sa pièce, Corneille garde le silence durant deux ans, mais il se ressaisit vite. Horace est joué en 1640, Cinna en 1642. Plusieurs œuvres se succèdent : Polyeucte (1643), La Mort de Pompée et Le Menteur (1644), La Suite du Menteur et Rodogune (1645). Mazarin accorde à son tour une pension à Corneille, qui connaît cependant un échec en 1646 avec Théodore ; puis il fait jouer Héraclius, en 1647, l'année même où il est élu à l'Académie française. La Fronde, qui commence en 1648, retarde jusqu'en 1650 les représentations d'Andromède : à cette date aussi Corneille inaugure la « comédie héroïque » avec Don Sanche d'Aragon, et la Cour le nomme à un poste considérable, celui de « procureur des Etats de Normandie ». En 1651, Nicomède remporte un succès éclatant, mais la pièce, qui pouvait apparaître comme l'éloge des princes révoltés contre la Couronne, déplaît au pouvoir ; l'auteur est privé de sa nouvelle charge et de sa pension. Après l'échec brutal de Pertharite, en 1652), il se retire de la scène de 1652 à 1658 et consacre ses loisirs à la traduction de l'Imitation de Jésus-Christ. En 1658 Fouquet, le nouveau mécène, prend Corneille sous son aile et celui-ci revient au théâtre en 1659 avec Œdipe. En 1660 paraît son Théâtre, revu et corrigé, avec les trois Discours sur l'art dramatique et les Examens de chaque pièce. Une fastueuse Toison d'or, donnée au Marais en 1661, tient l'affiche un an durant. L'arrestation de Fouquet prive Corneille d'un généreux protecteur, mais Louis XIV le pensionnera à partir de 1663. Installé désormais à Paris, l'écrivain compose successivement Sertorius (1662), Sophonisbe (1663), Othon (1664), Agésilas (1666), Attila (1667). Le parti des cornéliens ne cesse de porter aux nues « le Prince des auteurs de théâtre », mais c'est aussi le temps de la rivalité avec Racine dont la gloire étend son ombre sur celle du grand homme, obligé de constater que ses pièces ne soulèvent plus autant d'enthousiasme que par le passé. 1670 voit le duel des deux Bérénice, qui tourne à l'avantage de Racine. Pulchérie n'est qu'un demi-succès en 1672 ; l'échec de Suréna en 1674 pousse son auteur à prendre une retraite définitive, à l'âge de soixante-neuf ans. Malade, diminué, Corneille se survit jusqu'à soixante-dix-huit ans. Son nom domine non seulement son époque mais aussi toute la littérature dramatique ; ses pièces n'ont pas cessé d'être jouées et de fasciner les spectateurs. La tradition scolaire a, hélas ! défiguré et mutilé – en le réduisant à quelques grandes tragédies dites « classiques » – un univers dramatique d'une extrême variété et d'une féconde liberté. L'œuvre comprend une bonne trentaine de pièces (tragédies, tragi-comédies, « tragédies à machines », comédies, « comédies héroïques »), qui témoignent d'une constante curiosité et du désir toujours renouvelé d'explorer nombre des chemins de l'art dramatique. |
|