Ce qu'en
pense l'admirable Fénelon:
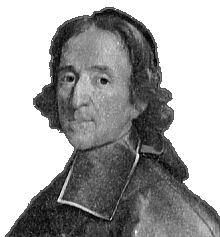 Je
n'ai jamais défendu ni ne défendrai ni directement ni indirectement
les livres de Mme Guyon comme réguliers dans leurs expressions;
mais je connais tellement ses intentions, par la confiance sans réserve
qu'elle a eue en moi, que je dois juger de ses écrits par ses sentiments,
et non de ses sentiments par ses écrits. Les autres, qui ne la connaissent
point, peuvent censurer ses écrits dans toute la rigueur des termes,
s'ils le jugent à propos: pour moi, j'ai une autre règle,
dont la justice ne me permet pas de me départir. Je ne veux ni excuser
sa personne, ni justifier ses livres; mais je ne dois jamais porter une
condamnation de ses livres, qui représenterait, par une conséquence
évidente, ses intentions comme abominables...
Je
n'ai jamais défendu ni ne défendrai ni directement ni indirectement
les livres de Mme Guyon comme réguliers dans leurs expressions;
mais je connais tellement ses intentions, par la confiance sans réserve
qu'elle a eue en moi, que je dois juger de ses écrits par ses sentiments,
et non de ses sentiments par ses écrits. Les autres, qui ne la connaissent
point, peuvent censurer ses écrits dans toute la rigueur des termes,
s'ils le jugent à propos: pour moi, j'ai une autre règle,
dont la justice ne me permet pas de me départir. Je ne veux ni excuser
sa personne, ni justifier ses livres; mais je ne dois jamais porter une
condamnation de ses livres, qui représenterait, par une conséquence
évidente, ses intentions comme abominables...
Supposé même que
Mme Guyon soit si condamnable, n'y a-t-il pas assez de gens qui la condamnent
sans moi? Tout le monde l'accable; personne ne la défend, et on
a toujours peur; on se fait des monstres pour s'alarmer. Où est
donc le péril de l'Église? J'aurais tout ensemble envie de
rire et de pleurer sur des craintes si vaines, et sur une affaire si déplorable.
Extrait
du Mémoire justificatif de Fénelon
L'homme qui écrit
est un solitaire qui s'adresse à un lecteur solitaire, soit qu'il
rédige une lettre d'amour, soit qu'il compose un roman d'aventures.
En revanche, l'homme qui parle a besoin d'un auditeur, car la parole solitaire
est d'un fou. L'orateur politique veut un public houleux, le prédicateur
religieux une paroisse recueillie, le conteur une assemblée villageoise
réunie autour de la cheminée, l'homme en prière l'immense
et invisible oreille de Dieu.
La parole franchit un court
espace, mais elle s'efface dans l'instant, alors que l'écriture
voyage à travers le temps et à travers l'espace. C'est que
la parole est vivante, tandis que l'écriture est morte. (...)
La parole est première.
Dieu créa le monde en le nommant. C'est le Verbe créateur.
L'écriture qui apparut des millénaires plus tard découle
de la parole, et a besoin d'elle pour l'irriguer. Toute l'histoire de la
littérature est faite de retours constants de l'écriture
à cette source vive et vivifiante qu'est le langage parlé.
Un grand auteur est celui dont on entend et reconnaît la voix dès
qu'on ouvre l'un de ses livres. (...)
Les sermons des grands prédicateurs
dont le texte nous est parvenu soulèvent un très intéressant
problème: dans quelle mesure ces sermons étaient-ils improvisés
- comme semble l'exiger la véritable éloquence - et ces textes
n'ont-ils pas été rédigés de mémoire,
après coup et donc «à froid» ? La question se
pose notamment pour Bossuet.
La parole humaine est à
mi-chemin du mutisme des bêtes et du silence de Dieu. (Louis Lavelle)
Dieu est le grand Solitaire
qui ne parle qu'aux solitaires et qui ne fait participer à sa puissance,
à sa sagesse, à sa félicité, que ceux qui participent,
en quelque manière, à son éternelle solitude! (Léon
Bloy)
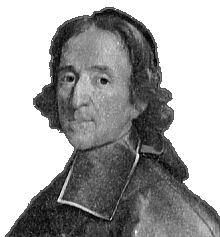 Je
n'ai jamais défendu ni ne défendrai ni directement ni indirectement
les livres de Mme Guyon comme réguliers dans leurs expressions;
mais je connais tellement ses intentions, par la confiance sans réserve
qu'elle a eue en moi, que je dois juger de ses écrits par ses sentiments,
et non de ses sentiments par ses écrits. Les autres, qui ne la connaissent
point, peuvent censurer ses écrits dans toute la rigueur des termes,
s'ils le jugent à propos: pour moi, j'ai une autre règle,
dont la justice ne me permet pas de me départir. Je ne veux ni excuser
sa personne, ni justifier ses livres; mais je ne dois jamais porter une
condamnation de ses livres, qui représenterait, par une conséquence
évidente, ses intentions comme abominables...
Je
n'ai jamais défendu ni ne défendrai ni directement ni indirectement
les livres de Mme Guyon comme réguliers dans leurs expressions;
mais je connais tellement ses intentions, par la confiance sans réserve
qu'elle a eue en moi, que je dois juger de ses écrits par ses sentiments,
et non de ses sentiments par ses écrits. Les autres, qui ne la connaissent
point, peuvent censurer ses écrits dans toute la rigueur des termes,
s'ils le jugent à propos: pour moi, j'ai une autre règle,
dont la justice ne me permet pas de me départir. Je ne veux ni excuser
sa personne, ni justifier ses livres; mais je ne dois jamais porter une
condamnation de ses livres, qui représenterait, par une conséquence
évidente, ses intentions comme abominables...