| Miguel de Cervantes
Saavedra, que l'on appelle Cervantès en français, est né
à Alcalá de Henares, le 29 septembre
1547, dans la famille d'un modeste chirurgien. Il passe son enfance entre
des frères et des sœurs nombreux, avant de se rendre à Madrid
pour y poursuivre ses études. Ses premières œuvres, publiées
en 1568, sont des poèmes dédiés à la mémoire
d'Élisabeth de France, fille d'Henri
II et de Catherine
de Médicis, reine d'Espagne, morte la
même année.
En 1569, il quitte l'Espagne pour Rome où, en 1570, il entre au service du cardinal Acquaviva avant de rejoindre à Naples un régiment espagnol. En 1571, il prend part à la bataille navale de Lépante, en Grèce, près de Corinthe, où les navires des chrétiens de la Sainte ligue battent la flotte turque ; il y perd la main gauche, ce qui lui vaudra bientôt le surnom de manchot de Lépante. |
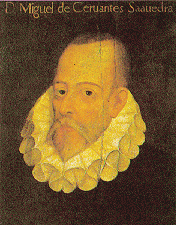 |
|
| En 1575,
alors qu'il fait voile vers sa patrie, il est enlevé par des pirates
barbaresques qui le réduisent en esclavage et l'emmènent
en Algérie, en attendant qu'une rançon soit versée
pour sa libération. Il essaie à plusieurs reprises de s'évader,
mais en vain, et doit attendre cinq ans que sa famille et ses amis aient
réuni la somme nécessaire à sa libération.
Quand il retrouve l'Espagne, en 1580, il est âgé de trente-trois ans ; mais, malgré ses hauts faits et le courage dont il a fait preuve au cours de sa captivité, aucune des familles de la noblesse ne consent à l'employer, de sorte qu'il consacre les années 1582-1585 à la composition de poèmes et de pièces de théâtre : mais en dépit de l'abondance de sa production, très peu de ces œuvres sont parvenues jusqu'à nous. Il fréquente pendant cette période les grands auteurs de l'époque, dont certains, comme Calderon, atteindront la célébrité. Lui-même commence à se faire un nom : son roman pastoral la Galatée, paru en 1585, connaît un certain succès, mais cela ne suffit pas pour assurer son existence matérielle. En 1584, il se marie avec doña Catalina de Palacios y Vozmediano, qui jouit de par sa famille d'une certaine aisance, et se voit alors confier par le gouvernement de l'époque de menues tâches comme l'approvisionnement de la flotte rassemblée par le roi Philippe II, connue sous le nom d'Invincible Armada, dans le but d'aller détrôner Élisabeth Ière et de rétablir le catholicisme en Angleterre ; il est également chargé de recouvrer les impôts, ce qui lui vaut d'être emprisonné à plusieurs reprises parce qu'on le soupçonne de détourner une partie des fonds collectés. Il mène donc une vie sans éclat, mais qui lui permet de parcourir l'Espagne de Séville à Madrid et de rassembler des matériaux pour son œuvre future. C'est en prison justement que, s'inspirant en partie de ses propres rêves de grandeur et de ses déboires, il invente un personnage persuadé d'être un chevalier errant en quête d'exploits semblables à ceux des poèmes épiques du Moyen Âge : la première partie du récit où il relate l'histoire de cet homme paraît en 1605, sous le titre l'Ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche... Le succès est foudroyant : dans les quinze jours qui suivent la parution de l'édition originale, trois contrefaçons sont mises sur le marche ! Au lieu de faire fortune grâce à son œuvre, Cervantès, qui n'a pas du tout le sens des affaires, est victime de l'engouement qu'elle suscite. En 1613, il publie un nouvel ouvrage qui fera lui aussi beaucoup pour sa notoriété : les Nouvelles exemplaires regroupent douze récits d'inspiration diverse, certains ressemblant à des romans en vogue en Italie ; d'autres constituent un tableau de la vie criminelle à Séville ; d'autres encore s'apparentent au genre fantastique par leur caractère étrange. Après avoir publié en 1614 le Voyage au Parnasse, un texte où il se livre lui-même sur le ton de la confession, il fait paraître en 1615 la deuxième partie de Don Quichotte, avant d'achever, quatre jours avant sa mort, en avril 1616, un roman fantastique et allégorique, les Travaux de Persilès et Sigismonde, paru l'année suivante. |
||