| Le jansénisme |
| I- Origine du jansénisme
Le jansénisme plonge ses racines dans la pensée de Saint Augustin. Il a été développé "théologiquement" par Cornélius Jansen (1385-1638) dit Jansénius, évêque d'Ypres qui reprend dans un ouvrage, « L'Augustinus », publié, après sa mort, en 1640, des thèses déjà présentées par Michel Baïus (1513-1589), professeur à l'université de Louvain. Le jansénisme s'inscrit en réaction contre l'humanisme et le molinisme. Le jansénisme a été diffusé en France par Jean Duvergier de Hauranne, abbé de Saint- Cyran, disciple de Jansénius. Il se développa d'abord au couvent de Port-Royal, où il fut introduit par la mère Angélique Arnauld. Il se répandit ensuite dans d'autres milieux ecclésiastiques, gagna la haute société parisienne, puis les villes de province. II- Le jansénisme : les données d'une hérésie Le Jansénisme revêt une forme doctrinale, celle de Jansénius, et une forme appliquée, celle de Port-Royal, et en cela il fait partie de la Réforme catholique française. C'est une réaction à la vision optimiste de l'homme et de ses capacités. 1°- L'homme est totalement déchu par suite du péché originel, il tend vers la mal de façon naturelle. Cette vision de l'homme est proche de la vision "calviniste" de l'homme. 2°- Seule la grâce de Dieu (grâce efficace, en opposition à la grâce suffisante, prônée par les jésuites), peut le pousser vers le bien, le pousser vers la « délectation céleste » et le détourner de la « délectation terrestre ». Cette grâce est efficace car elle guérit nécessairement ceux à qui Dieu l'accorde, il constitue un petit groupe d'élus. Cela rejoint l'idée de prédestination de l'homme développée par Calvin. 3°- Cette grâce exige de ceux qui la reçoivent, une foi à toute épreuve et un combat quotidien contre le mal : « à la morale de l'honnête homme, les jansénistes oppose celle de la sainteté » (René Taveneaux). 4°- Les jansénistes exigent de leur pénitent, une contrition parfaite (et non pas la simple attrition : regret des fautes par peur de l'enfer), pour leur donner l'absolution. On retrouve ici l'idéal d'intransigeance de Calvin, dans la pratique de la foi. Néanmoins le jansénisme n'est pas une doctrine statique, il s'est uni à des influences diverses. Il existe, en fait non pas un jansénisme mais des jansénismes, tous issus d'un même tronc commun mais différents en fonction de l'attitude face au monde. Il y a, ceux qui refusent toute participation à l'action temporelle (Martin de Barcos, 1600-1678), ceux qui ne font aucune concession et luttent pour le triomphe de leurs idées (Guillaume Le Roy, 1610-1684), enfin ceux qui à l'image d'Antoine Arnauld (1612-1694) acceptent la possibilité du compromis. III- Le jansénisme, la papauté et le Roi Très Chrétien de 1640 à 1715 Durant tout le XVIIe siècle, les relations, entre le jansénisme, ou ses acteurs, la papauté et la monarchie seront basées sur l'affrontement. On peut distinguer trois phases dans ces relations. 1°- Premières condamnations et résistance 1638 -1669 En effet le jansénisme est vite apparue comme un mouvement suspect voire d'opposition, cela engendra des sanctions politiques de la part de Richelieu, mais très vite, il est également condamné par Rome, du fait de l'action conjointes des Jésuites et de la politique française, c'est la bulle « In eminenti » en 1643, renforcée par la bulle « Cum occasione » qui déclare comme hérétiques ou fausses, cinq propositions de Jansénius. A cette date le jansénisme fut sauvé de deux manières, d'abord par la tactique d'Antoine Arnauld qui faisait la distinction entre le droit, les cinq propositions sont hérétiques, et le fait, les cinq propositions ne se trouvent pas dans l'Augustinus et également par l'action de Blaise Pascal qui dans ses « Provinciales » faisait passer le débat du plan de la théologie à celui des comportements éthiques. Néanmoins en 1657, le pouvoir tentait une dernière manoeuvre, en faisant prescrire, par l'assemblée du clergé, la signature, par tout ecclésiastique, d'un formulaire désavouant les thèses de l'Augustinus. Cette obligation fut confirmée par l'arrêt royal du 13 avril 1661. Les jansénistes opposèrent un refus obstiné, la communauté de Port-Royal quant à elle, subit plus de quatre ans d'emprisonnement dans leur abbaye, privée des sacrements. Rome, qui craignait un schisme et Louis XIV tout occupé à ses préparatifs de guerre avec la Hollande, souhaitèrent traiter. Le pape Clément IX reconnut la distinction du droit et du fait, ce fut la paix clémentine en 1669. 2°- La paix clémentine 1669 - 1700 Cette période fut une trêve brillante et féconde, durant laquelle Port-Royal devint le lieu de rassemblement de la haute société parisienne. Elle connut une floraison littéraire, avec les « Pensées » de Pascal publiées en 1670. Pasquier Quesnel publie en 1668 « Nouveau testament en français avec des réflexions morales sur chaque verset », cet ouvrage joua un rôle capital dans l'évolution du jansénisme. Tout ceci déplaisait fort, à Louis XIV, il croyait à l'existence d'une cabale. Le jansénisme, de par son individualisme apparaissait comme un danger pour l'autorité de l'Etat. Quand le roi s'engagea à l'intérieur comme à l'extérieur, dans une politique d'impérialisme confessionnel, il déclara leur perte. 3°- La fin de Port-Royal 1700 -1713 En 1679, les confesseurs, les pensionnaires et les novices furent expulsées de Port-Royal, le monastère était voué à l'extinction. En 1701, l'affaire dite « du cas de conscience », entraîna la reprise des persécutions. Louis XIV demanda alors au pape une nouvelle condamnation, ce fut l'objet de la bulle « Vineam Domini » en 1705. Puis Louis XIV décida d'agir par la contrainte, les principaux chefs jansénistes furent emprisonnés, éloignés. En octobre 1709, les religieuses de Port-Royal qui avaient refusé de signer la bulle « Vineam Domici » furent dispersées par la police. Deux ans plus tard, le monastère était rasé. Mais Louis XIV, alla plus loin, et demanda une bulle de condamnation globale du jansénisme tel qu'il s'exprimait dans l'oeuvre du chef du parti, Pasquier Quesnel. Le roi insista de telle façon que Clément XI exprima sa sentence dans la bulle « Unigenitus » le 8 septembre 1713. Cette dernière condamne les thèses augustiniennes sur la grâce, mais elle affirme également, même indirectement la prééminence de Rome sur l'Eglise de France, mais aussi le droit de contrôle du Saint-Siège sur les princes. Cette bulle qui devait en principe mettre fin au jansénisme allait lui rendre un nouvel élan en associant sa cause à celle du gallicanisme, fortement mal mené durant toute cette période. |
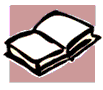 |
Guy Cabourdin. Lexique historique
de la France d'Ancien Régime. Paris, Armand Collin, 1998, 3e
éd
René Taveneaux. Catholicisme dans le France classique. Paris, Sedes, 1994. Tome 2 Chap X (p 299 à 327) Hildesheimer, F. Le jansénisme. Paris, Publisud, 1991. |
© j-b HISTOIRE sept 1999