| La puissance du roi : l'absolutisme religieux | ||
| L'époque est celle de la réduction de la société
à l'obéissance, mais cette réduction est à
nuancer, car elle ne commence pas en 1661, c'est un phénomène
beaucoup plus ancien, mais aussi, car cette réduction à l'obéissance
n'a jamais été parfaite, surtout dans le domaine religieux.
A son accession au pouvoir, Louis XIV a des moyens de surveiller son Eglise, en fait depuis le Concordat de Bologne de 1516, l'Eglise a une autonomie par rapport au pape, elle est gallicane, elle reconnaît l'autorité du Pape, mais elle est contrôlée par le roi. I- L'Eglise au service du roi Sous l'Ancien Régime, il existe un lien étroit entre le roi et l'Eglise, la monarchie est de droit divin, l'Eglise peut être l'instrument du pouvoir, elle peut se mettre au service du roi. A) La tradition: l'Eglise gallicane En 1516, le Concordat de Bologne est signé entre François Ier et le pape Léon X, il permet au roi d'être le maître du Haut Clergé, il remplace la Pragmatique Sanction de Bourges qui précisait que les évêques étaient nommés par les chanoines, les abbés élus par les moines. Désormais, évêques, abbés, archevêques, sont nommés par le roi, le roi désigne aux bénéfices consistoriaux et le pape doit se contenter de confirmer ces nominations et de donner aux élus, l'investiture canonique. Le roi peut nommer des membres des grandes familles nobiliaires à ces postes. Le Concordat de Bologne a deux contreparties reconnues par François Ier, il avait accepté qu'un concile universel soit soumis au pape, il a été décidé de rétablir les annates qui sont une taxe versée au pape à chaque mutation de bénéfice important (à chaque fois qu'un titulaire d'une abbaye change). Le roi est ainsi maître de son Eglise, il en nomme et contrôle les chefs. B) L'Assemblée du Clergé de France L'Eglise est organisée, elle dispose d'une représentation : l'Assemblée générale du Clergé, apparue en 1561 et devenue permanente en 1579. Elle se réunit tous les cinq ans, mais des assemblées extraordinaires peuvent également être réunies. La Grande Assemblée du Clergé est aussi appelée assemblée de Contrat, elle comporte 64 députés dont la moitié d'évêque et d'archevêque, elle est chargée de fixer le don gratuit. La Petite Assemblée du Clergé est constituée de 32 députés dont la moitié d'évêque et archevêques, elle vote le don gratuit, c'est aussi une instance de proposition politique. C) L'affaire de la Régale Il existe deux régales, la première est la régale temporelle, c'est le droit pour le roi de toucher les revenus des évêchés vacants, la seconde est la régale spirituelle, c'est le droit pour le roi de distribuer, à la place de l'évêque manquant, les bénéfices. En 1673-1675, le roi décide d'étendre son droit de régale à 53 diocèses de France, le pape est contre. Le conflit devient virulent en 1682, une assemblée extraordinaire du clergé se réunit et décide que le droit de régale est étendu au royaume tout entier, cette assemblée vote en mars, sous l'influence de Bossuet, de Le Tellier, la déclaration des Quatre Articles qui annonce la totale indépendance temporelle du monarque, rappelle les libertés de l'Eglise de France, précise que le pape n'est pas infaillible et que ses décisions peuvent être remises en cause par un concile général. En 1687-1688, le pape annule les libertés dont profitaient les quartiers d'ambassade à Rome et Louis XIV riposte en faisant occuper Avignon. En 1693, un compromis est adopté avec le nouveau pape, Innocent XII, l'extension de la régale est acceptée par le pape, les Quatre Articles sont reniés par le roi, le pape accepte d'investir canoniquement les membres du clergé français. Le roi n'est pas un ultramontain, il défend les français. II- Le rejet du jansénisme A) Le jansénisme, une hérésie Doctrine fondée en 1640, par Jansénius, dans l'Augustinus, dans cette ouvrage qui participe de la réforme catholique, elle oppose jansénistes et protestants, les jansénistes ont une vision pessimiste de l'homme, cette vision refuse l'idée de libre-arbitre, la grâce est une grâce qui est toujours efficace, elle n'est donné qu'à quelques rares élus, pour les catholiques, tout le monde a la grâce s'il le désire. Les jansénistes veulent purifier la foi catholique. B) Le roi contre les jansénistes Dès 1661, le roi demande à tous les ecclésiastiques de signer un formulaire rédigé de la manière suivante : « je condamne de coeur et de bouche, la doctrine des cinq propositions de Jansen contenues dans son livre « l'Augustinus ». Arnould trouve une parade, il condamne les propositions mais affirme en même temps qu'elles ne sont pas dans l'ouvrage de Jansen, il fait la distinction entre le droit et le fait, le droit, oui, les propositions sont condamnables, le fait, elles ne se trouvent pas dans l'ouvrage de Jansenius. En 1668-1669, le pape accepte la paix, ce sera la « paix clémentine ». Dès 1679, la lutte contre le jansénisme reprend. En 1679, les pensionnaires et novices de Port Royal des Champs sont expulsées, Arnould, Nicole et Quesnel fuient aux Pays Bas, ce mouvement se poursuit jusqu'en 1709, année où les dernières religieuses sont expulsées de Port Royal, en 1712, l'abbaye est rasée. C) La lutte contre le second jansénisme En 1692, Quesnel publie son nouveau testament en français avec des réflexions morales sur chaque verset, dans cet ouvrage, il reprend les idées de Jansénius, ainsi que des idées gallicanes, et des idées richéristes. Quesnel est arrêté à Bruxelles en 1703. En septembre 1713, le pape, sur la demande de Louis XIV, produit la
bulle Unigenitus qui condamne 101 propositions extraites de l'oeuvre de
Quesnel. Mais cette bulle pose le problème de l'intervention du
pape dans les affaires françaises. Cette bulle est enregistrée
fin 1713, début1714, des évêques protestent ainsi que
le Parlement de Paris, ils ne défendent pas le jansénisme
mais le gallicanisme.
III- Le roi contre les protestants A) De la surveillance à la répression Dès 1660, le roi est hostile au protestantisme, l'Assemblée du Clergé de France demande au roi une application stricte de l'Edit de Nantes, le roi accepte et met en place des commissions chargées d'examiner la régularité des consistoires, il y a destruction des temples protestants illégaux, environ 700 temples sont détruits de 1661 à 1685. En 1679, la France comptait 700 000 protestants, on cherche à les convaincre de se convertir au catholicisme, pour cela il y a la création d'une caisse des conversions pour les aider à devenir de bons catholiques. Dès 1678, la politique du roi change, c'est une véritable lutte contre le protestantisme qui commence, différentes mesures sont prises, en 1679, les dernières chambres mi-parties sont supprimées, en 1680, le mariage mixte est interdit, toujours en 1680, interdiction est faite aux catholiques de se convertir au calvinisme, en 1681, en Poitou, l'intendant Marillac procède aux premières dragonnades : il loge des dragons chez des protestants jusqu'à ce qu'ils deviennent catholiques.
B) La révocation de l'Edit de Nantes Cela se fait par l'Edit de Fontainebleau en octobre 1685. Le protestantisme recule, c'est le moment de l'éliminer. A l'est de l'Europe, le péril turc est particulièrement présent, les turcs ont été vaincus en 1683 au Khalenberg, les français n'y ont pas participé. Le roi est fâché avec le pape, il cherche à se réconcilier avec lui à propos de l'affaire de la Régale. La place de la France en Europe doit être affermie. Le 17 octobre 1685, révocation par l'Edit de Fontainebleau, ce texte fait une falsification des volontés de Henri IV, il comporte un long préambule, 12 articles, il y a interdiction d'émigrer, le texte n'oblige pas à croire mais le culte protestant est interdit. Cela va entraîner la naissance des Eglises du désert (églises occultes). La plupart des protestants deviennent des nouveaux convertis, il y a une évolution sensible du nombre des protestants, en 1770-1780, il y a environ 600 000 protestants en France. C) La résistance des protestants Elle s'organise et prend différentes formes, elle est d'abord
intérieure (passive), on pratique en cachette (révolte des
Camisards). Il y a le départ vers les pays du refuge (Angleterre,
Provinces Unies, Suisse, etc...). Le nombre de huguenots qui émigrent
se situe entre 100 000 et 150 000 personnes (certains auteurs parlent de
200 000 à 250 000 départs). Ils exercent toutes sortes de
professions : avocats, médecins, beaucoup d'artisans, de manufacturiers,
des paysans parfois. Ils ont créé des foyers d'opposition
qui étaient déjà en partie en place avant le révocation
: aux Provinces Unies avec Pierre Jurieu qui écrivait contre la
France et Louis XIV, les écrits vont se multiplier après
1685. En 1689, Pierre Jurieu publie probablement : « Les soupirs
de la France esclave », dans lequel il attaque la monarchie absolue
et Louis XIV. Cette critique de Louis XIV est relayée par les Etats
protestants, on ne peut pas comprendre la création de la Ligue d'Augsbourg
sans faire référence à la révocation .
L'absolutisme dans le domaine de la religion, n'a jamais été un succès total. L'Etat ne soumet pas toutes les communautés religieuses. Le règne de Louis XIV ne forme pas un bloc unique et cohérent, la répression contre les protestants commence avant 1661 (paix d'Alès), en 1724, sous Louis XV, on reprend une série de mesures contre les protestants, Louis XIV n'est pas une exception. |
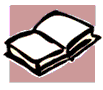 |
Lebrun, F. La puissance et la guerre1661-1715.
Paris, Point Seuil Histoire, 1997.
Emmanuelli, F-X. Etat et pouvoirs dans la France des XVI-XVIIIe siècles. La métamorphose inachevée. Paris, Nathan, Coll Fac-Histoire, 1992. Poton, D., Cabanel, P. Les protestants français du XVIe au XXe siècle. Paris, Nathan, Coll 128 Histoire, 1994. Garrisson, J. L'Edit de Nantes et sa révocation. Histoire d'une intolérance. Paris, Point Seuil Histoire, 1985. |
